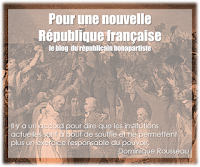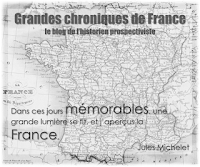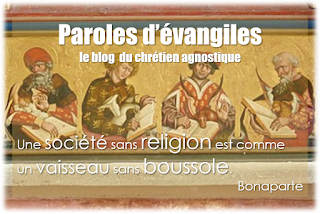Guerre au Haut-Karabagh : quels enseignements ? - Par Patrick Jakob
Du 27 septembre au 10 novembre 2020 d’importants combats ont opposé l’armée d’Azerbaïdjan aux forces arméniennes du Haut-Karabagh. Quatre ans plus tard, quels enseignements tactiques est-il possible de tirer de cette guerre ?
Par le Chef d’escadrons Patrick Jakob (armée de Terre)Abonnez vous à la Revue Conflit (revueconflits.com)
Le 19 septembre 2023, après presque un an de blocus, l’Azerbaïdjan relance son offensive face à la république autoproclamée du Haut-Karabagh au mépris du droit international. En à peine vingt-quatre heures, l’Artsakh cesse de résister et dépose les armes. Cette défaite rapide reste l’épilogue de 45 jours d’intenses combats qui se sont déroulés fin 2020 dans cette même région.Ce conflit met en lumière la domination permise par une haute maitrise technologique dans un affrontement moderne de haute intensité, en particulier l’usage des drones et des réseaux sociaux. Au-delà de cet aspect conjoncturel, cette campagne de 2020 peut être étudiée au prisme de trois principes structurels de la guerre du maréchal Foch et de l’amiral Labouérie : les Arméniens ont perdu cette guerre lorsque leur liberté d’action a disparu, tandis que les Azerbaïdjanais ont su vaincre grâce à la concentration de leurs efforts et à la foudroyance de leur campagne.
Le Haut-Karabagh : un territoire disputé manquant de profondeur stratégique.
Le Haut-Karabagh mesure 11 000 km² et compte 150 000 habitants. Ce territoire fait ainsi la taille de la Gironde pour une population équivalente à celle d’Angers, ce qui représente une faible densité humaine. Avec une altitude moyenne de 1 100 m, des forêts denses et un maillage routier peu développé, le terrain ressemble beaucoup aux Préalpes françaises. Il est à souligner que le pays n’est relié à l’Arménie que par un seul accès goudronné : le corridor de Latchine. Il reste donc logistiquement totalement dépendant de cet unique axe de ravitaillement.
À la dislocation de l’URSS en 1991, le Haut-Karabagh proclame son indépendance. Pour rétablir leur contrôle sur le Haut-Karabagh, les autorités azerbaïdjanaises envoient alors des troupes, ce qui déclenche une guerre jusqu’en 1994, année d’un cessez-le-feu. Les laborieuses négociations pour la résolution finale du conflit sont ensuite organisées dans le cadre du Groupe de Minsk débouchent sur un équilibre instable : en 2016, les violences reprennent lors de la guerre des Quatre Jours, déclenchée par une attaque azerbaïdjanaise qui cependant échoue.
Sans véritables négociations diplomatiques, toutes les conditions sont réunies pour que les combats reprennent.
Un combat inégal
À la veille des combats, l’Arménie/Artsakh et l’Azerbaïdjan ont des effectifs équivalent au sein de leurs forces terrestres. Toutefois, le matériel de guerre de Bakou domine nettement celui de son adversaire. En effet, l’Azerbaïdjan possède par exemple quatre fois plus de chars. Bakou dispose également de plus de moyens aériens en quantité et en qualité. La différence est particulièrement marquée dans le domaine des drones. Plus globalement, le budget de défense de Bakou est près de six fois plus important que celui de l’Arménie.
Au bilan, il existe un réel déséquilibre des forces que les Arméniens pensent pouvoir compenser par leur « terrain forteresse » et aux forces morales liées à la défense de leur territoire, comme ils l’ont fait depuis 30 ans. Leur système défensif se compose principalement d’un réseau de tranchées adaptées au terrain, mais qui reste peu protégé contre les attaques aériennes. Ils conservent une artillerie et une défense antiaérienne d’origine soviétique de bonne qualité mais dont les caractéristiques (longueurs d’ondes et fréquences radar, portée, …) sont bien connues de leurs adversaires. Leurs chars sont maintenus en réserve et ont pour rôle principal d’organiser des contre-attaques si nécessaire.
Au niveau international, la Turquie soutient l’Azerbaïdjan, principalement en raison de leur proximité culturelle. Le slogan « une seule nation, deux États » illustre cette vision commune du monde turc, qui se concrétise par des exercices militaires bilatéraux réguliers. La Russie reste neutre. Sa préférence pourrait aller à l’Arménie, surtout par opposition à la Turquie. Toutefois, Moscou n’apprécie pas le nouveau régime arménien, nationaliste, qui a un discours hostile à l’influence russe.
Le 27 septembre 2020, l’Azerbaïdjan lance l’offensive. Les combats débutent par des tirs d’artillerie et des frappes de drones. En quelques heures, la défense antiaérienne arménienne est en grande partie anéantie. En quelques jours, le parc blindé arménien est globalement hors de combat dans toute la profondeur de son dispositif défensif. L’offensive terrestre azerbaïdjanaise marque alors son effort au sud.
Après 44 jours d’intenses combats, les troupes azéries atteignent Chouchi, la porte du corridor de Latchine.
Néanmoins, la victoire n’est pas encore totalement acquise, d’autant que l’Azerbaïdjan épuise son stock de munitions. De plus, la Russie ne souhaite pas une victoire azerbaidjanaise, qui permettrait à la Turquie d’asseoir son influence dans la région. Après de multiples appels à la fin des combats, la destruction d’un hélicoptère russe le 9 novembre sera la raison invoquée pour imposer un cessez-le-feu. Moscou déploie alors une force d’interposition.
Au final, les pertes s’élèvent à environ 25 00 morts dans chaque camp, soit plus de 100 morts par jour. Au niveau du matériel détruit, les volumes sont également importants. Pratiquement tous les chars, toute l’artillerie et tous les lance-roquettes du côté arménien ont été détruits. Les pertes sont moindres pour les Azerbaïdjanais, mais ils perdent pratiquement tous leurs drones (voir tableaux en annexe 3).
Vidéo : La chute du Haut-Karabakh arménienLe système défensif du Haut-Karabagh en lui-même a contribué à la perte de la liberté d’action arménienne. Il est constitué d’une double ligne de défense : une à la frontière et l’autre à environ 20 km en retrait. Il s’agit de simples tranchées en pierre et de postes de combat. Ce dispositif statique est complété par une division blindée capable de colmater une éventuelle brèche. La grande vulnérabilité de ce dispositif statique est sa faiblesse face aux attaques aériennes, en particulier du fait de l’endurance des drones alors que les défenses aériennes arméniennes ne sont plus opérationnelles.
C’est la raison pour laquelle, dès le quatrième jour de l’offensive, la contre-attaque arménienne avec une division blindée se solde par un échec : 80 chars et des dizaines de blindés sont détruits.
Ainsi, en quelques jours, les troupes arméniennes sont clouées au sol par des frappes dans toute la profondeur du pays. Elles sont sous la menace permanente des drones et deviennent incapables de renforcer et de soutenir les unités au combat. Il en résulte que chaque position défensive se bat seule, jusqu’à sa destruction ou à l’épuisement de ses munitions, face à l’inéluctable avancée azerbaïdjanaise.
Face à un ennemi privé de toute liberté d’action, l’Azerbaïdjan concentre ses efforts à bon escient jusqu’à obtenir la victoire.
Pour cela, il effectue une diversion avec l’attaque d’un corps d’armée au nord du Haut-Karabagh, mais son effort principal demeure au sud. Il y engage son 2ème Corps d’armée, composé de cinq brigades mécanisées. Le 5ème Corps d’armée, en réserve, est ensuite engagé dans cette zone au bout d’une semaine d’offensive. Ces corps finissent par être encore renforcés par le 3ème Corps d’armée. Ainsi, 30 à 40 groupements tactiques interarmes sont engagés contre 20 groupements arméniens dans une zone de 50 kilomètres de front. Bakou concentre donc une force importante, mais surtout elle relève continuellement ses troupes alors que les Arméniens s’épuisent sans possibilité de relève et de renfort.
Le terrain choisi pour l’offensive est une zone moins montagneuse que le nord de l’Artsakh. Cela permet à l’Azerbaïdjan de déployer ses chars, ses véhicules blindés et son artillerie en appui de l’infanterie. La manœuvre consiste d’abord en une conquête de tout le sud du Haut Karabagh jusqu’à la frontière arménienne, puis en une convergence des forces vers Chouchi qui est la porte d’entrée du corridor de Latchine et la voie d’accès vers la capitale Stepanakert. Il est ainsi possible de noter une concentration marquée des efforts vers cette ville forteresse, qui finit par tomber. Cette chute marque la fin des combats.
A lire aussi : L’Arménie est trop dépendante de la Russie. Entretien avec Gevorg Melikyan
La foudroyance azérie
En sus de cette concentration des efforts, la campagne se démarque par sa foudroyance. Les Azerbaïdjanais multiplient les interventions audacieuses et parviennent à accélérer brutalement le tempo des opérations. Ce phénomène est principalement permis grâce à deux facteurs de supériorités opérationnels : la coopération et la masse.
La coopération est renforcée par l’adoption du modèle turc de complexe « reconnaissance-frappe ». En effet, le command and control, les moyens et les modes d’actions azerbaïdjanais permettent une synergie entre les drones, les troupes au sol, l’artillerie et la guerre électronique. Ce système est d’autant plus performant qu’il se fait dans la profondeur du dispositif arménien même lorsque la météo ne permet pas aux drones de surveiller, de frapper ou de guider des tirs. Cela est possible grâce à quelques centaines de commandos – appelés aussi « saboteurs » – vraisemblablement formés en Turquie, qui s’infiltrent dans les lignes ennemies. Ces hommes guident les tirs de l’artillerie et fournissent des informations tactiques pour le reste des troupes au sol. Il est à noter que le but de ces équipes n’est pas de détruire des cibles à haute valeur ajoutée, mais bien d’appuyer directement l’offensive terrestre.
Les forces azerbaïdjanaises renforcent leur « masse » dans plusieurs domaines grâce à un volume d’équipement important importé de l’étranger.
Elle utilise par exemple 600 lance-roquettes multiples, soit dix fois plus que les Arméniens. De plus, ce matériel est souvent plus moderne. Bakou dispose notamment de char T90 alors que Stepanakert possède des T72 plus anciens. La masse est également augmentée grâce aux drones. Les Arméniens n’en possèdent pas, tandis que l’Azerbaïdjan utilise une trentaine de drones militaires, dont dix drones turcs TB2 Bayraktar, et environ 200 drones suicide HAROP israéliens. Enfin, la Turquie aurait activement soutenu son partenaire grâce à l’envoi de supplétifs : environ un millier de mercenaires de l’Armée nationale syrienne (ANS), financés et équipés par la Turquie, auraient ainsi été envoyés pour combattre. L’envoi de ce type de troupes supplétives permet de disposer d’hommes aguerris, disposant de modes d’actions non conventionnels et pouvant être perdus sans que cela n’ait d’effet sur les familles azéries.
Ainsi, les combats du Haut-Karabagh en 2020 marquent le retour de la guerre de haute intensité aux portes orientales de l’Europe. Cette guerre se démarque par sa visibilité sur les réseaux sociaux et la prédominance des drones au combat. Elle préfigure en cela la guerre russo-ukrainienne déclenchée par Moscou le 24 février 2022. Il convient toutefois d’admettre que ce conflit reste singulier, en raison de la nature du terrain, fortement montagneux et faiblement peuplé. Il ne peut donc constituer un cas d’école pour la plupart des affrontements contemporains, où les zones urbaines sont de plus en plus denses et de plus en plus nombreuses, à l’instar de l’Ukraine. Frédéric Chamaud et Pierre Santoni expliquent à ce propos que la zone urbaine est « égalisatrice de technologies » dans leur ouvrage L’Ultime Champ de bataille. Combattre et vaincre en ville. La question de la foudroyance s’exprimerait sans doute de façon différente dans ces milieux cloisonnés, où l’avantage des drones et des actions dans la profondeur reste relatif.